« Le génocide rend le passé plus présent que le présent lui-même. »
***
« Pourquoi ce tapage, ce n’est qu’une guerre tribale de plus ? »
C’est ainsi, qu’au printemps 1994, je balaie le Rwanda dans les oubliettes de ma mémoire.
Vint ce temps des Fêtes de 2000, vint cette lecture d’Un dimanche à la piscine de Kigali, de Gil Courtemanche, qui me dévoile qu’après le massacre des Arméniens, la Shoah et les atrocités des Khmers rouges, on pouvait encore commettre pire.
Je ne fus pas seul à ignorer ce génocide des Tutsi. Dans l’ouvrage collectif Le choc, publié chez Gallimard à la fin de l’hiver 2024, bien des participants – des journalistes, des écrivains, des historiens, des artistes – témoignent de leur « rendez-vous manqué » au printemps 1994. Ils sont, toutefois, partis à la rencontre du Rwanda par leurs travaux d’investigations, par leurs créations artistiques et par leurs récits personnels, dans les semaines, les mois et les années suivantes.
Ce recueil regroupe trois décennies d’écriture de l’événement par des Rwandais, des Français et des Belges. Les textes sont intimes et instructifs : ils jettent un regard accablant sur les violences extrêmes, les lâchetés et les collusions, mais aussi sur la faillite de la communauté internationale qui laisse les Tutsi à l’abandon. Ce regard se tourne aussi sur la prise de conscience, trop tardive, d’un génocide prémédité et planifié.
Après l’amère victoire du FPR en juillet 1994, triomphant au milieu d’une pile de cadavres de civils « si haute, si haute ». « On savait qu’il y avait des tueries mais aucune idée de la proportion. » Après la fuite des génocidaires au Congo (suivie de cette affreuse épidémie de choléra au camp de réfugiés de Goma, nourrissant l’infâme théorie du double génocide), José Kagabo, intellectuel engagé, exilé en France depuis 1974, effectue un voyage dans son pays natal : « Je suis parti en sachant qu’il y avait eu des morts dans ma famille ». Ses « Notes de voyage », « rédigées à chaud », vacillent entre « rigueur et violence de l’observation, justesse et fragilité des interprétations ». Comment comprendre ce génocide de proximité ? Comment comprendre qu’une communauté pourchasse des gens avec qui elle avait toujours vécu ? « Ça relève plutôt de la psychanalyse, » avance Kagabo. « [I]l n’y a pas d’autres rationalités qui tiennent (…) Difficile de faire la part des choses entre les grands et les petits coupables. »

On trouve des éléments de compréhension de l’histoire coloniale (« La colonisation et la fabrique ethnoraciale » de Léon Saur). Les Belges vont créer de toutes pièces des ethnies, faisant des éleveurs des Tutsi, une « race de seigneur » perçue « comme supérieur aux Hutu ». Par la suite, la « révolution » de 1959 invente un Rwanda indépendant présenté comme « la patrie des Hutu occupée pendant des siècles par les Tutsi ». L’idéologie de l’extermination prospère. Tout est déjà en place, avant même 1994. Des tentatives « d’éradication » surgissent en 1963, en 1973 et en 1993. On ne s’étonne pas de la survenance, mais de l’ampleur du génocide en 1994.
Aujourd’hui, dans un Rwanda « affecté de l’obsession de la propreté (Scholastique Mukasonga , « Journal de voyage »), on prône le vivre-ensemble, on met le couvercle « sur le chaudron des passions identitaires » (Jean-Paul Kimonyo, « Une tragique expérience historique »). On criminalise même l’usage des termes ethniques dans la sphère publique.
Le passé demeure, malgré tout, toujours présent. Marie Darrieussecq, « écrivaine voyageuse », y voyage en 2015. Là-bas, elle croise des veuves, des « naufragées » du génocide « laissées avec pire que la mort ». Ces femmes s’interrogent : pourquoi des génocidaires « sont toujours en liberté, en France, dans l’impunité » ?
Ceux-ci se défendent (« La négation au tribunal, le procès Neretse », de Jean-Philippe Schreiber) en falsifiant l’histoire : « Un procès contre nous, mais c’est une machination. Les vrais génocidaires, c’est la communauté tutsi, agissante, intrigante, actuellement au pouvoir, à Kigali ».
Et il y a des lâchetés, des collusions qu’on ne peut plus ignorer. Laurent Larcher (« Mourir à soi-même ») et Philippe Denis (« Un conflit de mémoire : Église et génocide ») s’interrogent sur le rôle de l’Église rwandaise dans cette tragédie : « Aucune parole publique au sujet du génocide des Tutsi n’a été prononcée » par l’Église catholique. François Robinet (« Le Rwanda, si loin, si proche ») et Stéphane Audoin–Rouzeau (« La brèche ? Retour sur la fin du déni français »), surtout, questionnent l’attitude attentiste du gouvernement français lors des premières semaines du massacre : une attitude qui, comme le confirme la commission Duclert en 2021, a rendu possible le génocide. L’ignoble président François Mitterrand savait, mais ne disait rien, ne faisait rien. Le président François Mitterrand m’est insupportable.
Nous prenons conscience « de la magnitude et de la singularité » de cette tragédie, « l’événement majeur, peut-être, de la fin du XXe siècle ». Souhaitons aussi, comme le propose Henry Rousso en postface de l’ouvrage (« Il n’est jamais trop tard »), que le Rwanda prenne sa place dans la mémoire universelle, qu’il devienne ce « passage obligé de l’historiographie du temps présent et, plus encore, de la conscience contemporaine ».
– Christian Vachon (Pantoute), 30 juin 2024
Le choc
Issus de diverses disciplines, des auteurs rwandais, belges et français interrogent les sources culturelles, idéologiques, sociales et politiques du génocide des Tutsi trente ans après le drame. L'accès aux archives, la préméditation et la mise en oeuvre des crimes, les façons de commémorer et de reconstruire font partie des sujets étudiés.
AcheterRetrouvez toutes nos références
Notre catalogue complet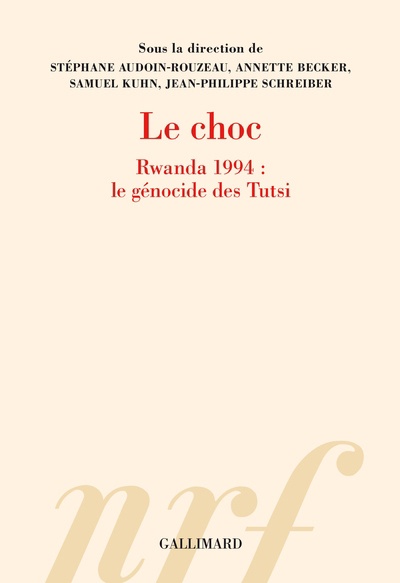
Commentaires