Pas de « et si », ni de « c’est la faute d’un tel ou d’un tel » dans ce Les Plaines d’Abraham : Champ de bataille de 1759 et 1760, publié conjointement ce printemps sous la direction experte d’Hélène Quimper, par l’éditeur Boréal et la Commission des champs de bataille nationaux. Non, on vous offre mieux que de débattre. Voici plutôt une rigoureuse synthèse, en moins de 150 pages, judicieusement garnie d’illustrations et de cartes, de tout ce que vous devez savoir sur les Plaines. Sur le « pendant » de cette fatidique année 1759, mais surtout sur « l’avant » et « l’après ».
Deux chapitres substantiels sont consacrés à ce « pendant » (chapitre 3 : « Le siège », et 4 : « La bataille ». On y explique comment on tente de « résister jusqu’à la paix » en concentrant, au printemps 1759, les forces (« à vouloir tout conserver, le risque de tout perdre est grand ») autour de Québec, cette place forte si périlleuse, supposément, à atteindre. C’est la consternation donc, lorsqu’au mois de juin, on voit déboucher la flotte britannique (49 navires de guerre) à la pointe de l’île d’Orléans. Cette dernière est reconnue pour être la meilleure au monde, et elle le prouve, lorsque dans la nuit du 18 au 19 juillet, à la surprise à nouveau, des assiégés français, un vaisseau et deux frégates remontent le fleuve, au-delà de Québec, en passant sous le feu de l’artillerie de la basse ville.
« On peut être battu, c’est un malheur ordinaire, ou plus faible, mais le comble de l’infortune, c’est d’être surpris » confesse l’officier français Montbeillard, contestant, avec désarroi, la réussite de l’ultime exploit de cette imprévisible « perfide Albion » : le débarquement « très risqué », mais gagnant, de l’Anse-au-Foulon, dans la nuit du 12 au 13 septembre. Puis ce fut la bataille.
Voilà pour le « pendant ». Mais comment en sommes-nous venus là ? Pourquoi les Britanniques mettent-ils le paquet pour éliminer la présence papiste française au nord de l’Amérique ? Les deux premiers chapitres (chapitre 1 : « Les tensions », et 2 : « La guerre ») nous gratifient de cette indispensable mise en contexte, nous font reculer à cet « avant » qui relativise tout, éclaire tout.
Tout débute, en fait, en 1754, bien à l’ouest, au confluent des rivières Ohio, Alleghany et Monongahela, dans un lieu connu, aujourd’hui, sous le nom de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les Français, avec le soutien de leurs alliés autochtones, y bâtissent un fort baptisé Duquesne, prenant possession d’un vaste territoire qui risque de confiner les colonies britanniques dans les limites de leurs frontières.
C’est la panique, la crainte d’un encerclement en Nouvelle-Angleterre et en Virginie. On crie à l’aide au souverain britannique. Pendant ce temps, en Europe, un « ballet diplomatique est en cours ». « Les royaumes sont conscients qu’il y aura bientôt la guerre. Ils ne savent toutefois pas encore avec qui et contre qui ils la feront ».
Cette guerre est officiellement déclarée le 18 mai 1756. La France s’allie, cette fois, avec l’Autriche pour lutter contre la Grande-Bretagne et la Prusse. Le Canada lui est nécessaire pour détourner les forces britanniques du continent européen. Stratégie heureuse : le premier ministre anglais William Pitt, déterminé, y envoie d’importantes armées.
En 1756, de considérables renforts français (près de 13 000 soldats réguliers) sont également dépêchés en Nouvelle-France. On fait toutefois face à un vaste problème logistique : « Comment approvisionner tous ces soldats ? Comment les nourrir ? ». Y a-t-il assez de ressources, au Canada, alors que la Royal Navy domine les mers, pour résister à l’Angleterre ?
Rien n’était décidé, le soir du 13 septembre 1759, après cette défaite des Plaines. C’est le temps de « l’après ». Au chapitre cinq (« L’hiver »), un terrible sentiment d’isolement s’empare des troupes britanniques, tentant de survivre en pleine saison hivernale (« les vivants enviaient presque les morts »), dans des maisons qu’ils ont eux-mêmes gravement endommagées par leurs bombardements de l’été 1759.
Le 27 avril 1760, les troupes françaises prennent même leur « revanche » (chapitre six), à Sainte-Foy (« l’autre bataille » des Plaines), repoussant la garnison britannique à l’intérieur des murs de la ville dévastée. Débute alors un nouveau siège. Lévis, le commandant français, est toutefois incapable de percer une brèche dans l’enceinte. Et le 9 mai, une voile se pointe sur le fleuve, celle d’une frégate anglaise. C’est la fin (septième chapitre : « Vers la paix »). Montréal se rend le 8 septembre.
Au huitième et dernier chapitre (« L’héritage) s’engage une autre bataille, celle de la sauvegarde des Plaines d’une urbanisation dévoratrice, tandis qu’un projet audacieux, celui d’honorer, de façon égale, « vainqueurs et vaincus » (« reconnaitre une défaite sans concéder la victoire »), sur les sites des combats, tant aux Plaines qu’au parc des Braves, survit, tant bien que mal, jusqu’à nos jours.
Bref, un ouvrage de référence, méticuleux, et tout à fait estimable, sur un lieu, chargé d’émotion, de la mémoire collective québécoise.

Les plaines d'Abraham
Ce livre met la bataille des plaines d’Abraham en contexte, relate les événements de 1759 et 1760, et s’intéresse à la postérité de ce moment historique. Une synthèse claire et rigoureuse qui tient compte des recherches historiographiques les plus récentes. Un beau livre qui comporte plus d’une centaine de documents iconographiques et imprimés, dont certains rarement vus du grand public.
AcheterRetrouvez toutes nos références
Notre catalogue complet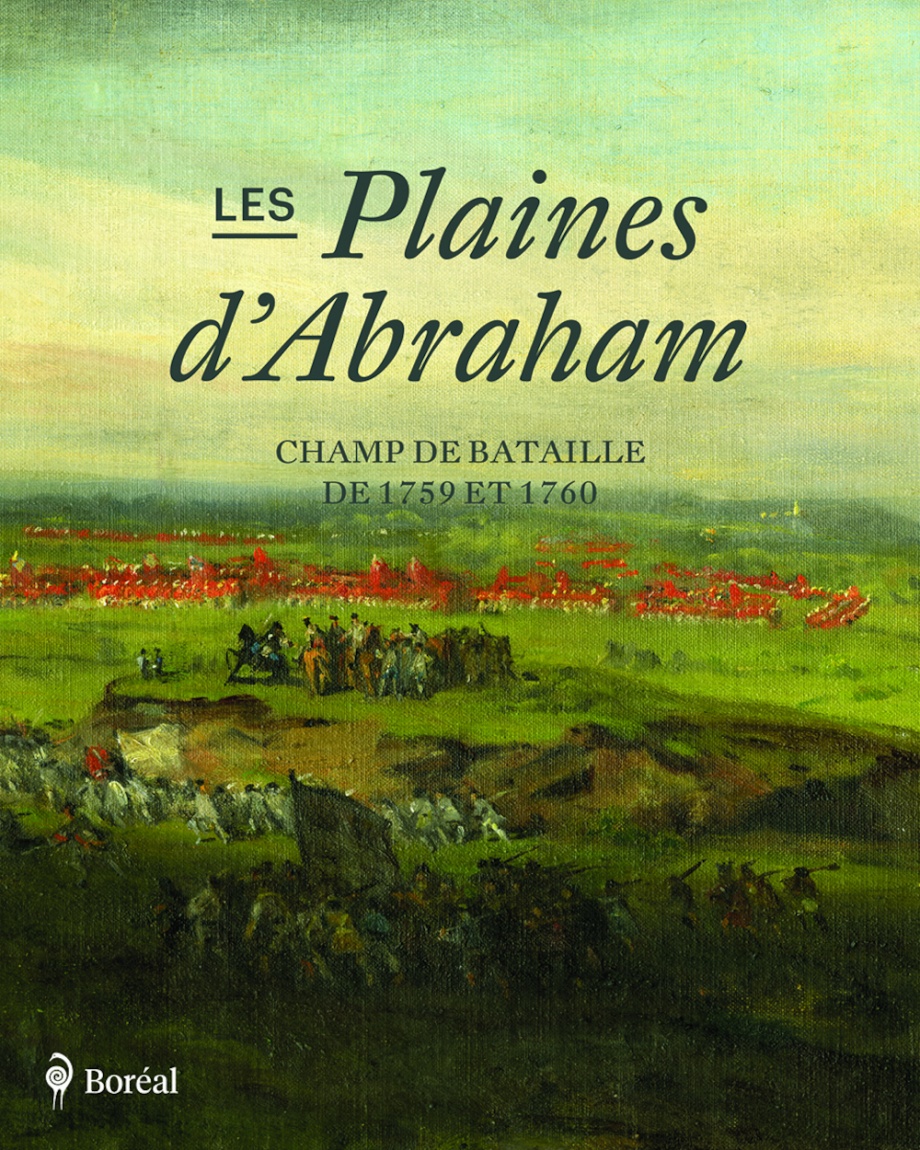
Commentaires